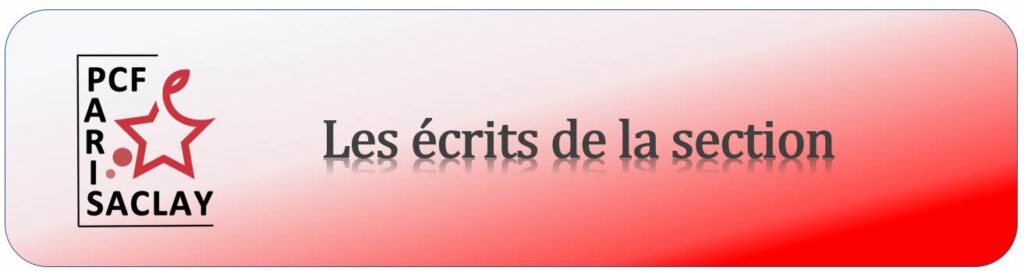
Debout pour les libertés académiques, et maintenant ?
Après les attaques obscurantistes sans précédent de la communauté scientifique aux États-Unis – Valérie Masson-Delmotte (coprésidente du groupe n°1 du GIEC de 2015 à 2023) parlant elle-même sur France Inter de « moment orwellien » – il est nécessaire de réaffirmer la nécessité développer les connaissances par la recherche et la formation et de garantir leur accès à toutes et à tous avec des moyens associés. C’est la recherche et la connaissance scientifiques qui sont visées. Jamais il n’a jamais été autant important de défendre la liberté académique. Cette liberté académique (de recherche, pédagogique, de publication et d’expression dans le cadre académique) est essentielle au fonctionnement démocratique d’une société et devrait être défendue par tout établissement d’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR) et ses personnels.
Or, malgré les annonces du Ministre chargé de l’ESR pour accueillir les scientifiques travaillant aux États-Unis via le programme PAUSE, celui-ci a été amputé de 60 % de ses moyens et les budgets de l’ESR sont repartis à la baisse de 1,5 milliard d’euros en 2025 après une saignée de 1,1 milliard d’euros annulés auparavant. L’objectif de dépenser 3 % du PIB pour l’ESR publics ne sera toujours pas atteint tandis que le sommet de l’État pourrait décider de consacrer jusqu’à 5 % du PIB pour la défense nous projetant dans une course aux armements qui privera le pays de moyens pour les services publics, pourtant essentiels en période de crise.
Faire la guerre et mourir ou bien se former et travailler, la réaction politique de notre communauté scientifique doit être à la hauteur du moment orwellien qui se joue aussi en France.
Mais l’Enseignement Supérieur et la Recherche français traversent eux aussi une nouvelle étape de transformation toujours plus néfaste !
La nouvelle autonomie des Universités (ou LRU 2.0) promue par notre Ministre mais aussi ses prédécesseurs vise à mettre en place des Contrats d’Objectifs, de Moyens et de Performances (COMP), outils permettant à l’État de conditionner les subventions des établissements à l’atteinte d’objectifs chiffrés. Cette démarche risque de réduire encore le peu de distance au modèle des États-Unis encore existant et qui fait la force du service public de l’ESR :
- en transformant les organismes de recherche en agences de moyens (dont la Ministre Montchalin a décidé qu’un tiers des agences hors Universités seraient supprimées ou fusionnées),
- en soumettant les établissements à des indicateurs quantitatifs et arbitraires (calculés hors sol par l’administration ministérielle, les rectorats ou des agences sans élaboration démocratique avec les personnels),
- en promettant une dotation à 100 % toujours plus austéritaire incluant la masse salariale (donc des rémunérations compressibles voire même un démantèlement des statuts).
Ainsi, en théorie, un établissement n’atteignant pas les taux de réussite et d’insertion, et pourquoi pas une certaine quantité de publications, fixés par le gouvernement, ne serait plus en mesure de payer ses personnels. Toute cette austérité serait orchestrée sans humain, simplement calculée par les outils administratifs comme InserSup, Fresq et Quadrant : quelle que soit la raison d’un objectif non atteint, le solde ne sera pas versé ! Comme souvent en bureaucratie (et même ici en technocratie), on masque une question politique derrière un outil technique. L’autonomie n’est plus que le choix d’atteindre les objectifs hors sol fixés par l’État, avec le risque que l’atteinte à tout prix pour sauver ses budgets dérive en une dépréciation des contenus des formations et des recherches menées.
L’océan atlantique ne nous protège pas des attaques d’une droite et extrême droite françaises et européennes inspirées par leurs homologues américains. Il nous faut réagir et se mobiliser pour dire quelle Université nous souhaitons, quelles institutions indépendantes des pouvoirs nous souhaitons et quelle société nous souhaitons.
Le PCF de l’Université Paris-Saclay vous invite à une réunion d’échange et réflexion pour poursuivre les mouvements en cours et porter des messages forts à la Présidence contre ce recul des libertés académiques et des droits des personnels et usagers orchestré par le gouvernement.
Le Nobel et le chaudronnier
Ce texte est la version courte d’un texte paru dans le dernier numéro de la revue Progressistes.
Il a été écrit par un camarade à partir de son expérience professionnelle et militante de plus de 50 ans sur le campus d’Orsay .
Chaque année, les pays riches se félicitent de la nomination d’un des leurs à l’un des
prix Nobel scientifiques. La France y tient une place très honorable. Le caractère personnel de ces nominations pourrait laisser penser qu’elles couronnent quelques cerveaux éclairés. C’est partiellement vrai, car les idées nouvelles proviennent de
personnes très engagées dans une discipline, mais c’est aussi une vision très éloignée de la réalité du travail scientifique. Par-delà le mérite des récipiendaires, la fertilité du travail de recherche est le fait de collectifs de travailleurs aux spécialités très diverses qui mettent en commun leurs savoirs et leurs savoir-faire. Le plus grand mérite d’un prix Nobel est peut-être d’avoir été capable de s’appuyer sur les connaissances disponibles pour les porter plus loin.